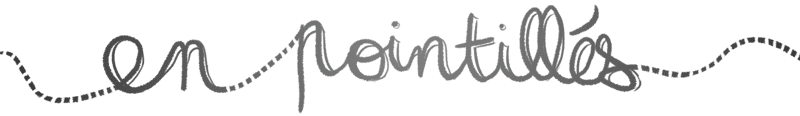5 avr. 2018
28 mars 2018
Mélisse
De ses deux index elle martèle le clavier de son ordinateur en insistant lourdement sur la touche entrée pour prouver à tout l’open space qu’elle travaille bel et bien. Puis, après un léger soupir, elle se courbe sur sa chaise, fait craquer sa nuque d’un geste net et précis. On y va ? semblait demander la nuque au reste du corps. Question rhétorique à laquelle son dos s’empresse de répondre et comment, je suis cre-vé d’un long craquement qui fait zigzaguer ses lèvres.
Je regarde Mélisse accomplir son rituel pré-départ d’un œil attendri, parce que, voyez-vous, j’aime beaucoup Mélisse. Nous sommes voisines de bureau depuis quelques années maintenant. Elle me dit bonjour d’un immense sourire tous les matins, et passe une main sur mon épaule chaque soir avant de partir. Elle baisse toujours un peu la voix lorsqu’elle décroche le téléphone pour ne pas trop me déconcentrer, me siffle comme un chat pour faire une pause clope quand ma tête est à deux doigts d’exploser. Mélisse a le don de tomber à pic. C’est le genre de nana qui te met un gobelet bien chaud de bon café sous le nez avant même que tu n’aies pu réaliser en avoir envie ; le genre à placer les bons mots aux bons moments, à rire de tout mais de personne hormis elle-même.
Elle rassemble l’océan agité de feuilles empilées sur son bureau en un joli paquet rectangulaire et uniforme. Mélisse n’est pas maniaque, mais elle aime les choses propres avec de jolis angles droits. Frange impeccablement coupée et lissée à quatre-vingt dix degrés, col bateau et motifs géométriques un peu partout, elle cherche à envoyer valser ses courbes. Elle les discipline, les contraint, les tord et les casse comme un fil de fer sous un marteau. Les formes géométriques, c’est son plus grand dada. Au coin supérieur droit de son bureau est posé un tétraèdre, plus communément appelé “pyramide régulière”. A l’opposé, au coin supérieur gauche, un dodécaèdre - ou polyèdre à douze faces. Tous deux parfaitement lisses, recouverts d’une clinquante couche de métal doré et auréolés de poussière.
Ils trônent là, lui ouvrent une haie d’honneur chaque jour. Elle les aime. Je vois à quel point elle les aime grâce à l’éventail des descriptions qu’elle peut en faire selon l’interlocuteur. Presse-livres, presse-papiers, bibelots, ou même sex toys, elle ne manquait jamais d’inspiration pour leur inventer une vie auprès des autres, quand moi, et moi seule avait le droit à l’authentique.
Elle me disait attendre patiemment une loi physique et quantique qui viendrait contredire toutes les autres, et renverserait sa pyramide sur sa pointe, base vers le ciel. Que là, et seulement là, elle croirait au parfait équilibre, au yin et au yang, à l’ordre et au chaos, au bien et au mal. Puis riait de toutes ses dents en appuyant du bout du doigt sur la pointe, accordant volontiers que, oui, d’accord, c’est pas demain la vieille. Puis, elle tendait la main vers le dodécaèdre et le balançait d’une face à l’autre, jonglant entre faces, arêtes et pointes, cherchant l’équilibre parfait sans jamais parvenir à mettre le doigt dessus. Pour elle, les formes géométriques étaient les témoins d’une rigidité, d’une complexité, d’une angulosité qu’on retrouve chez la plupart des êtres humains. Réfractaires à la différence, ces mêmes êtres, pourtant envahis de sphères et de courbes les méprisaient ouvertement.
C’est à n’y rien comprendre, m’avouait-elle en baissant le regard.
Moi je suis capable de voir la beauté dans ces formes. Dans toutes les formes. Est-ce que je suis la seule ? Et, face à mon silence, elle baissait la tête, vaincue.
Clac, clac, fait la tranche des feuilles sur le bureau à mesure qu’elle les tasse. Elle me regarde, sourit puis soupire, avant de déloger le crayon prisonnier de ses cheveux, qui tombent désormais sur ses épaules rebondies. Ses jolis doigts potelés et vernis massent sa nuque qu’elle fait craquer à nouveau, une fois, puis deux. Un nouveau soupir, différent. Un gémissement, un cri de douleur étouffé. Son regard est posé sur les paquets de gâteaux vides qui jonchent son bureau. Elle sait qu’elle va devoir les transporter sans pouvoir tous les dissimuler, le long du couloir qui nous sépare du local à ordures, où trône le container de recyclage. Elle sait qu’elle devra croiser les regards, supporter les jugements muets.
Je suis déjà debout, une main sur son épaule. Laisse ça, je m’en occupe. File.
Elle se lève à son tour et évite mon regard, mais j’entends de la reconnaissance dans son à demain, tout comme elle perçoit aisément ma sincère sympathie dans mon bonne soirée ma belle, le même que je lui adresse tous les soirs non sans vouloir l’accompagner d’une étreinte pour apaiser le brasier de sa honte. Je me réfrène, car je sais qu’elle préfère gérer ça seule, le plus loin possible des regards et des remarques, même les plus bienveillantes. Alors je la regarde attendre l'ascenseur, emmitouflée dans son manteau douillet et son écharpe enroulée une demi douzaine de fois autour de sa nuque fatiguée, sa silhouette détourée par les éclairages cliniques des bâtiments voisins. Le ding de l’ascenseur l’engloutit pendant que j’empile les cadavres de paquets de gâteaux, récupère les sachets plastiques qui embaument encore l’air de parfums sucrés, les entasse dans la petite poubelle de bureau en remuant son contenu comme on répartit la vinaigrette sur une salade.
Je brouille les pistes, je dissimule les indices, je falsifie les preuves, j’étends la scène de crime.
Quelques sachets de bonbons finiront leur course dans ma propre poubelle, quand d’autres atterriront négligemment dans celle d’Irène, l’hôtesse d’accueil qui ne fait même pas un peu semblant d’avoir du respect pour nous.
Sur le bureau de Mélisse, les grains de sucre brillent à la lumière de sa lampe comme autant de paillettes sur ses paupières. Une rivière de petits diamants à sa surface bleu marine que je balaye d’un revers de main. Tabula Rasa. Du moins jusqu’à demain.
* * *
De mon souffle court naît de jolis volutes qui emperlent le léger duvet de ma lèvre supérieure. J’aime cet échange tacite entre le monde et moi, cette sensation de discuter avec le vide et ce souvenir humide de la nuit sur mes lèvres. L’étiquette de mon écharpe cousue à la va-vite irrite mon cou chaque fois que ma tête pivote, et je me dis une nouvelle fois qu’il faudrait prendre le temps de la défaire. Comme environ cinquante pour cent de mes vêtements, elle porte mon nom écrit en lettres rouge sur fond blanc. Une étiquette personnalisée de la taille d’un ongle de pouce ; vestige d’un temps où ma mère, inquiète de constater la malhonnêteté du monde, m’envoyait en colonie de vacances pour officiellement m’amuser et profiter de l’été ; quand officieusement je devais promouvoir notre famille et prendre grand soin des dorures de notre blason. Mélisse Bacart. Pas une chaussette n’y avait échappé et, si je me concentre assez, je peux sentir le petit label synthétique frotter ma cheville. En avant, en arrière.
Chacun de mes pas claque plus que de raison sur le béton ébréché de l’avenue principale que mes talons finissent de raboter. Je ne marche pas vite, je prends mon temps. J’écoute le rythme que soufflent mes bottines au sol, et il m’emporte loin, très loin, quelque part au-delà de l’équateur, sous un soleil différent de celui que nous connaissons. Là où je vais, je n’ai besoin d’aucun vêtement. Je ne suis même plus certaine de posséder un corps ; il n’y a que l’air, le soleil cajoleur, la musique de mes pas et moi, qui danse sans jamais m’épuiser ni me lasser. Plus aucune limite physique, je ne suis qu’une onde qui vibre au gré des éléments, aussi légère qu’une plume se tortillant dans les bourrasques de vent. Je vais là où la musique me porte et parfois, je rêve de ne jamais revenir, ne jamais regagner ce corps qui encombre cet appartement que j’appelle maison sans qu’il ne me ressemble en rien.
Le cliquetis de la clé dans la serrure sonne comme une fausse note dans le tam-tam de mes pensées et m'arrache à mon voyage astral. La porte se referme derrière moi, et ce soir, plus que jamais, je me sens étrangère à ce monde, cette ville, ce lieu sombre et étriqué. Les cadres accrochés dans le couloir de l’entrée ne m’évoquent rien, pas même une passion aujourd’hui éteinte, pas même l’ombre d’un regret. Les fenêtres nues ajoutent à l’ambiance chirurgicale de l’appartement soulignée par l’éclairage blanc et froid, comme l’intérieur d’un frigo tristement vide. Sur le comptoir, et sans même y penser, je sors des placards poussiéreux ce dont j’ai besoin : pain de mie et fromage à tartiner, un immense bocal d’olives noires rempli aux deux tiers et des bâtonnets de crabe qui contiennent probablement autant de crabe que mon fromage à tartiner, mais je fais l'autruche, au moins autant que Schrödinger face à la vie de son chat. Et puis, je ne suis pas entrée en mode pilote automatique pour subitement examiner la composition des aliments que je m'apprête à ingérer ; je sens l'urgence, le besoin qui monte et j'aime ça autant que ça me fait horreur. Il est temps de commencer, le plus vite sera le mieux.
Je déroule mon écharpe dans une spirale de tissu bariolé, déboutonne mon manteau, déchausse mes bottines, et range tout soigneusement dans le placard avant de relever mes manches et faire un crochet par la salle de bains pour laver mes avant-bras avec la minutie d’un chirurgien sur le point d’opérer.
Là, et seulement là, je suis prête à accomplir une chorégraphie parfaitement maîtrisée. Le temps devient mon ennemi, il me toise, me nargue tapi quelque part dans l’un des recoins ombragés de l’appartement. Nous nous défions, nous entrons en concurrence. Désormais, nous sommes sans pitié l’un pour l’autre et ne nous ferons aucune faveur. La compétition sera rude, mais je suis une challenger de taille, et surtout : je sais ce que je fais et je connais la chanson sur le bout des doigts. Mon couteau attrape au passage l’exacte dose de fromage qui vient tartiner le pain de mie d’une couche ni trop fine, ni trop épaisse. Une bouchée, une olive. La mastication me libère les mains : de la droite, j’étale à nouveau le fromage sur le pain comme un peintre sur sa toile, tandis que de l’autre j’appuie sur l'extrémité d’un bâtonnet de crabe pour le libérer de sa prison de plastique et je l’avale en trois bouchées égales.
En temps normal, les bâtonnets de crabe sont un met que je savoure. Je les déshabille délicatement de leur couche de plastique, les déroule et les effeuille, lamelle après lamelle. Procéder ainsi leur offrirait presque des qualités gustatives qu’ils n’ont pas autrement.
Mais je suis en crise. Au diable le goût.
Il s’agit de remplir chaque centimètre cube de mon corps de ces aliments qui occupent chacun de mes neurones au quotidien ; ces images édulcorées, comme sorties tout droit d’un glossy magazine, à leur avantage sous leur meilleur profil, leurs couleurs saturées aux rehauts de lumière retouchés, imprimées dans les méandres de mon cerveau du matin au soir, et du soir au matin.
Et il s’agit de le faire vite, avant que la raison ne m’arrête, avant que des signaux électriques confus n’arrivent à mon cerveau avec l’ordre que tout cela cesse. Avant de donner une chance à la honte de m’anéantir, de me frapper quand je suis déjà à terre.
Je me bats contre la trotteuse de l’horloge, je la défie. Je maîtrise mon temps, mon corps à la perfection, respire quand il le faut, juste ce qu’il faut. Ma bouche est pleine à capacité maximum, et j’alterne la mastication. Droite, gauche. J’avale. Et je répète l’opération ad nauseam.
Lorsqu’il ne reste plus que des emballages vides et des miettes sur tout le comptoir, je jurerait que la trotteuse s’affole, comme pour rattraper son retard, réduire la distance entre nous avant de s’éloigner définitivement en m’adressant un signe d’adieu dans son rétroviseur. Et je reste seule, au bord d’une route poussiéreuse et déserte à marcher sans but. Je marche pour me garder en vie, pour ne pas sombrer, ne pas succomber à la douleur des spasmes, ne pas tourner de l’œil en sentant mon estomac s’élargir ; en l’imaginant se débattre, se tordre de douleur, saturer. Je me sens lourde, fiévreuse, étourdie. Je transpire de cette sueur froide, âcre, celle qui goutte le long de la colonne vertébrale et fait frissonner tout le corps. Celle qui sent la peur et le dégoût.
Je marche, un pas après l’autre, et je nettoie. J’efface les preuves. Je brouille les pistes.
Sur le comptoir, les miettes constellent le plan de travail comme autant d’étoiles dans un Ciel que je ne connais plus. Une voie lactée de déchets compostables que je balaye d’un revers de main. Tabula Rasa. Du moins jusqu’à la prochaine crise.
* * *
L’aube est claire ce matin, c’est étrange. Voilà des semaines que le ciel nous cache son nuancier sous un épais coton, et ce matin, comme par magie, les dégradés de rose refont surface et s’estompent petit à petit avec le lever du soleil. Les oiseaux chantent à nouveau et la température est agréable. Une matinée d’un printemps prématuré, et déjà les plus carencés profitent des rayons de soleil en terrasse en dégustant leur café-croissant.
L’effet du beau temps sur l’humeur générale m’a toujours fascinée. C’est uniquement les jours comme celui-ci que Mélisse trouve du répit au bureau. Tout le monde est bien trop occupé à surveiller la météo et en discuter autour de la machine à café pour prêter attention à ce qu’elle ingère. Ou pas, d’ailleurs. Personne pour lui envoyer des regards obliques et des rires à peine étouffés lorsqu’elle peine à se baisser pour ramasser ce stylo qui ne fait que lui échapper, personne pour lancer des paris idiots sur la taille de son manteau ou celle de son jean. Et c’est tant mieux.
Parfois, je me surprends à prier au moment du coucher que le temps soit clément le lendemain, simplement pour voir Mélisse sourire et vivre sa vie tranquillement, avec tout ce qu’elle comporte de difficultés et de petits bonheurs, sans personne pour l’observer comme un animal en cage. Que le monde la laisse être une succession de courbes au milieu d’angles plus ou moins droits.
Une fois n’est pas coutume, je décide de faire un détour par le parc et d’arpenter ses petits sentiers sinueux. Ici et là, de petites mares aménagées abritent poissons et grenouilles qui perturbent la tranquillité de la surface. Leur chant entre en résonance avec celui de quelques criquets confus par la douce matinée impromptue. Deux chaises plantées au bord de l’eau semblent attendre le chaland. Je nous revois, Mélisse et moi vissées à ces chaises, lors d’un jour comme celui-ci, imiter les grenouilles, rire de nos bêtises tout en prenant le soleil, son petit nez retroussé rougi par les rayons sans pitié du zénith. Au milieu de cette nature domestiquée, elle me confiait ses angoisses, ses névroses, sa maladie tout en jetant des miettes de pain aux poissons quémandeurs. Ses regrets face à la vie, le travail, la famille avoués à demi-mots derrière un sourire triste. Et ses éclats de rire qui transcendaient son visage quand j’éructais bruyamment sans crier gare, après une gorgée de soda.
C’est décidé, ce midi, nous poserons à nouveau nos royaux postérieurs sur ces chaises et ferons cuire nos visages déshabitués aux rayons solaires. Les amphibiens seront les témoins privilégiés de notre bonne humeur. Ce sera bien.
J’arrive au bureau la bouche en coeur malgré mon quart d’heure de retard. Aucune tête ne se lève ni se tourne sur mon passage, je suis aussi invisible et incolore qu’un léger courant d’air sur la nuque. Irène ne s’embarrasse pas d’un bonjour ni même d’un signe de tête, elle est bien trop absorbée par ce magazine féminin qui cristallise probablement l’essence même de ses propres complexes. Car Irène préfère se faire du mal avant de faire du mal aux autres et briser l’ego des indignes du statut de femme, en lieu et place d’accueillir ses pairs, comme indiqué sur son curriculum vitae.
Autour de la machine à café, on chuchote et on étouffe des éclats de rire. On fait des messes-basses en suivant du regard de pauvres âmes à qui la vie ne fera jamais de cadeaux.
Tous les matins c’est la même chose, ils m’horripilent, tous autant qu’ils sont pendant quelques minutes, leur dédain mettant à l’épreuve ma bonne humeur légendaire. Pourtant, je suis habituée à ma cape d’invisiblité, et je la chéris entre ces murs bien volontiers. Car tout le monde n’a pas la chance d’en posséder une.
À mesure que je progresse dans le long couloir, glissant devant les bureaux de collègues ignorant jusqu’à mon prénom, je ne peux m’empêcher de noter que la luminosité générale baisse de manière significative. Les rayons du Soleil ont tout simplement cessé de nous parvenir, ou même d’exister, éclipsés par un je-ne-sais-quoi qui ne présage rien de bon. Je sens naître une frayeur, une angoisse, un pressentiment au creux de mon estomac fleurir jusqu’au bout de mes doigts, fourmiller dans mes oreilles et hérisser mes poils.
Quelque chose dans l’atmosphère a changé, un vent provenant du Nord s’est subitement levé et fouette les carreaux dans un sifflement semblant colporter une alarme, un avertissement. L’air n’a plus le même parfum, plus la même densité. Dans l’obscurité d’une matinée de printemps disparue, les battements de mon cœur s’emballent comme une volée de tambours militaires, raccourcissant mon souffle et asséchant mon palais.
Au contact de ma chaise de bureau, des tremblements s’emparent de mes mains. Dans le creux de mon dos coule une peur qui marbre ma peau laiteuse.
J’évite scrupuleusement de porter mon regard sur la droite de la pièce car je sais.
Inscription à :
Articles (Atom)